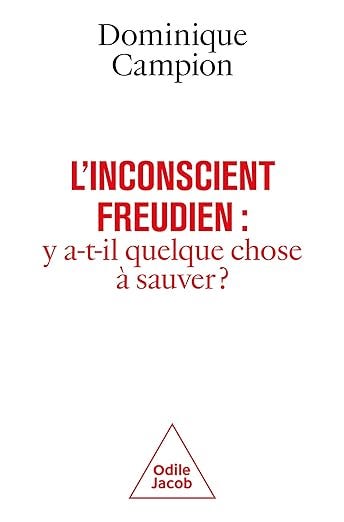Comment ne pas prendre Freud au sérieux?
Une critique d'un récent livre de Dominique Campion
Je ne suis pas le premier à critiquer Freud, et je ne serai malheureusement pas le dernier. Cependant, toutes les critiques ne se valent pas. Certaines sont honnêtes, mais peu convaincantes, car mal construites, ou peu rigoureuses. D’autres sont malhonnêtes. D’autres encore ne sont simplement pas sérieuses. C’est le cas du récent livre de Dominique Campion L’inconscient freudien : y a-t-il quelque chose à sauver ? Le titre est prometteur. L’auteur est psychiatre, spécialiste de la schizophrénie, et directeur d’un laboratoire de neurogénétique. Alors pourquoi pas ? Mais le livre fait pschitt ! L’auteur avait manifestement envie de se faire plaisir en écrivant un livre qui lui permet de lier ses différentes sujets de prédilection tout en ayant un angle un peu racoleur. Mais personne n’a dû lui expliquer que l’on construit un essai comme on monte une mayonnaise, si l’on ne mélange pas bien le tout, rien ne prend, et l’on se retrouve avec un bidule liquide sans le moindre intérêt.
Si le titre s’interroge sur Freud, le livre lui consacre à peine 50 pages. Sur les près de 200 qu’il compte, c’est peu ! L’essentiel du livre traite des travaux actuels en neuroscience sur la question de la mémoire, de la schizophrénie, et de l’autisme. Il est certain que ces sujets sont fascinants, et Campion à des choses à dire puisqu’il en est spécialiste. En revanche, cela est sans grand intérêt lorsque l’on veut faire une critique sérieuse de Freud. La conclusion présente quant à elle la vision angoissante que l’auteur se fait du monde contemporain. Ce n’est ni vraiment un livre sur Freud, ni vraiment un ouvrage de science populaire. Autant dire que j’ai eu l’impression de perdre 24 euros !
Une vision épistémologiquement naïve
Avec un peu d’information sur l’auteur et le contenu du livre, il est clair que la réponse qui sera offerte à la question du titre ne peut être qu’un non retentissant. Évidemment qu’il n’en tirera rien. Campion est un neuroscientifique et la psychanalyse freudo-lacanienne qu’il prend pour cible est conceptuellement incompatible avec le paradigme scientifique dans lequel il s’inscrit. On aurait pu à la rigueur espérer un travail conceptuel de fond permettant une tentative d’opérationnalisation de la psychanalyse. Quelque chose qui permettrait une sorte d’évaluation rigoureuse des hypothèses psychanalytiques. Mais Campion s’en tient au degré zéro de la réflexion. Son projet « d’examiner si (…) les élaborations freudiennes peuvent nourrir le projet propre des neurosciences » (p. 20) ne peut qu’être voué à l’échec tant il est animé par une vision épistémologiquement naïve. N’est pas philosophe qui veut.
La discussion du chapitre 2 sur le concept de pulsion est à ce titre édifiante de pauvreté. Centraux chez Freud, qui n’a eu de cesse d’affiner ces concepts tout au long de sa vie, la pulsion et les conflits pulsionnels sont à la base de tout le psychisme humain. On peut penser ce que l’on veut de l’œuvre scientifique du pervers de Vienne, il n’en reste pas moins que ses écrits théoriques ne souffrent pas de la comparaison avec ceux de Nietzsche ou de Bergson. Il faut toute la naïveté de Campion pour les réduire à trois fois rien :
Les deux conceptions [neuropsychologique et psychanalytique] s’accordent sur l’idée générale d’une maturation du psychisme dû à la nécessité pour l’enfant de passer d’un stade où prévaut la satisfaction immédiate des désirs à une position ou la prise en compte de la réalité extérieure, et des inévitables frustrations qu’elle implique, prime. (p. 41)
Lisant cela, j’ai eu envie de hurler « C’est tout !? » et de lancer le livre contre un mur. Ainsi réduite la psychanalyse n’est plus vraiment de la psychanalyse et les neurosciences ne disent rien d’intéressant. C’est d’une banalité sans nom. Et c’est en plus tellement général que c’est trivialement vrai ou factuellement faux. La conclusion à laquelle Campion arrive sur la notion même de pulsion est à peine mieux.
Débarrassé de sa connotation sexuelle exclusive, cette définition de la motivation n’est finalement pas si lointaine de celle de pulsion freudienne, première mouture. (p. 28)
Outre que la « connotation sexuelle » est si centrale pour Freud, qu’il s’est brouillé avec tous ceux qui tentaient de la faire disparaître, Campion passe complètement à côté des subtilités qui font que le concept de pulsion en psychanalyse n’a pas grand-chose à voir avec le concept de motivation en neuroscience. La pulsion trouve la source de son énergie en elle-même pour tendre vers un but, alors que la motivation qui n’a pas besoin d’énergie, sauf métaphorique, trouve sa source dans le but lui-même et la récompense qu’il offre. Tout cela n’est guère sérieux.
Un exercice d’équilibriste manquée
Avec le reste du livre, on oscille entre gâchis de papier et survol tout à fait adéquat de l’état actuel des connaissances. Ce n’est pas un livre sur l’intérêt de la psychanalyse, c’est un mauvais livre sur les thèses freudo-lacaniennes, mais c’est aussi un livre à peu près correct sur le fonctionnement de l’esprit. C’est à se demander si le livre a eu un éditeur.
Le chapitre 3 sur le refoulement est une parfaite illustration de l’exercice d’équilibriste auquel s’adonne Campion qui finit inexorablement par une chute. Un survol rapide des thèses qui y sont présentées pourrait faire croire que la conclusion qui s’impose est que nos connaissances actuelles sur le fonctionnement de la mémoire rendent impossible l’existence du refoulement freudien. Pourtant, la naïveté épistémique de Campion ne peut l’empêcher de tenter de jouer sur deux tableaux :
En présentant les choses de cette manière, sommes-nous si loin de ce que Freud, armer de ses seules métaphores avait pointé ? Avons-nous besoin d’évoquer l’élusif processus de refoulement pour installer solidement des processus inconscients au cœur de notre psychisme ? (p.68)
Le freudisme se réduirait à faire apparaître la part d’inconscient qui habite l’esprit ? Outre que la thèse est fausse, elle ne présente strictement aucun intérêt. S’il faut écrire un livre de près de 200 pages pour en arriver à affirmer ça, autant se taire !
Les chapitres 4 et 5 sont fascinants pour qui veut en apprendre plus sur la génétique et la neurologie de la schizophrénie et de l’autisme, mais pour la discussion avec Freud ou Lacan, on repassera. Il est évident au bout de quelques lignes qu’il n’y aura rien à tirer de leurs élucubrations. Pourquoi alors s’étendre si longtemps ? Pourquoi s’imposer ce détour à Freud ? L’objectif est-il d’attaquer la vulgate psychanalytique ? Ou de présenter l’état actuel de nos connaissances ? La lecture du livre donne l’impression d’assister à un spectacle de funambules refusant d’admettre qu’ils ne savent pas tenir en équilibre sur le fil qu’ils se sont efforcés de tendre.
Le plus frustrant dans cette histoire, c’est qu’il existe des manières de tenter d’atteindre l’objectif que s’est fixé Campion. Il est possible de prendre Freud au sérieux, d’essayer de le lire pour voir ce que l’on peut en tirer, de comprendre ce qu’il dit et voir ce qui résiste à l’examen critique. Les livres de Macmillan ou Grunbaum font cet effort, pas celui de Campion. Son indécision et son imprécision donneront des munitions aux freudiens, soit pour leur permettre de dire « mais vous voyez qu’il ya des parallèles à faire », soit pour leur permettre de critiquer les neuroscientifiques « qui manque quand même franchement de finesses, vous ne trouvez pas. » Bref, ne lisez pas ce livre, allez lire autre chose.