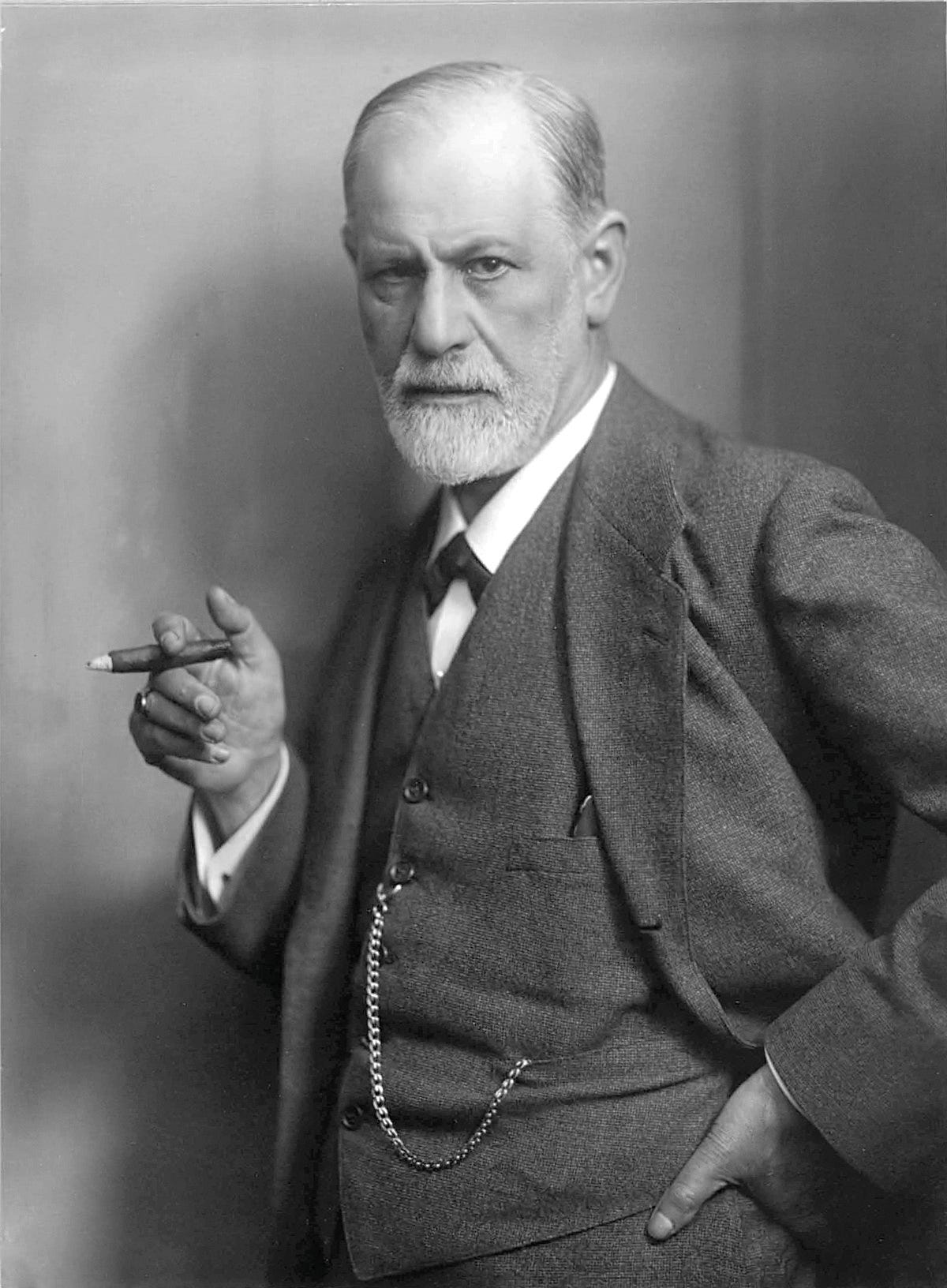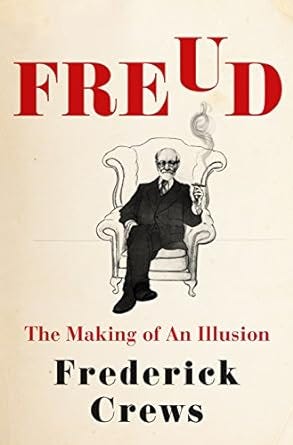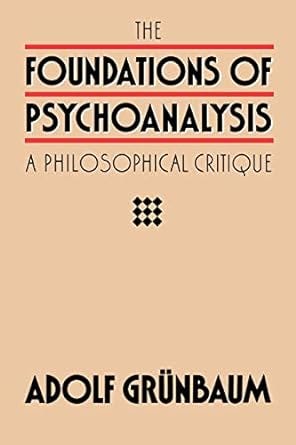Pour en finir avec Freud
Les grandes lignes d'un long projet
Freud est mort, ou du moins il devrait l'être. Pourtant, malgré ce que certains prétendent, l'ombre de Freud continue de planer sur nous. En France, la psychanalyse occupe toujours une place particulière tant chez les psychologues que dans la culture populaire. Les rayons des librairies regorgent de ses ouvrages, et de nouvelles traductions sont régulièrement publiées et plébiscitées. Les psychanalystes publient en masse sur toutes sortes de sujets. Cela fait 15 ans que la publication du Livre Noir de la Psychanalyse a déclenché la "guerre des psys", mais rien n'a changé. Rien n'a changé non plus après les différentes escarmouches des “Freud wars”. Freud et la psychanalyse occupent toujours une certaine place dans l'enseignement de la psychologie. The Personality Puzzle de D. Funder et Personality : Theory and Research, deux manuels de référence sur la psychologie de la personnalité, consacrent chacun plusieurs chapitres à Freud et à la psychanalyse.
Pour qui connaît un tant soit peu l’histoire des sciences, cela n’a rien de surprenant. Comme le remarquait Max Planck, les idées ne changent pas à coup d’arguments, mais seulement quand les générations changent. On pourrait croire et espérer qu’elle finira par disparaître d’elle-même une fois ses défenseurs disparus. Cela dit, les idées ont aussi leur force d’inertie et si rien n’est fait, Freud et ses ombres pourraient continuer de danser encore longtemps, bien qu’il existe d’excellentes raisons de vouloir s’en débarrasser.
Mon impression, fondée sur la lecture de Freud et de la psychologie contemporaine, est que la psychanalyse freudienne n'est rien d'autre qu'un tissu d’absurdité qui n’a rien à faire dans un cursus universitaire de psychologie. Son étude devrait être laissée aux seuls historiens des idées. Je réserve toutefois mon opinion sur la psychodynamie contemporaine et la neuro-psychanalyse pour plus tard. Ce sont peut-être des champs de recherche fertiles. Je n'ai pas lu suffisamment de choses à leur sujet pour avoir un avis éclairé sur la question, mais j'ai bien l'intention de les explorer sous peu. En revanche, il me semble que pour devenir des disciplines fécondes (si elles le sont bien), elles ont dû expurger un certain nombre d'idées freudiennes. Ce qui n'est pas un signe encourageant pour les psychanalystes classiques.
Les arguments contre la psychanalyse
Il me semble que quatre lignes d'argumentation justifient un rejet presque complet de Freud et de la psychanalyse. Je vais les présenter brièvement dans ce billet, mais j'ai l'intention de me replonger dans la psychanalyse pour développer ce qui ne sont pour l'instant que des intuitions. Chacune de ces pistes de réflexion n'est pas rédhibitoire en soi, la psychanalyse freudienne peut survivre à chacune d'entre elles prises séparément. Néanmoins, il me semble évident que leur conjonction est fatale. Toute théorie scientifique serait rejetée si elle souffrait de tels défauts.
La première idée, peut-être la plus évidente, est que les meilleures données dont nous disposons actuellement pour expliquer le comportement humain sont incompatibles avec les théories de Freud. Je n'entrerai pas aujourd’hui dans le détail de ces données, ni n'essaierai de montrer pourquoi elles sont incompatibles avec le freudisme ; je prendrai le temps de le faire plus tard, pour présenter le dossier le plus complet possible. Un freudien pourrait répondre que ce sont nos théories et nos données actuelles qui sont à rejeter. En effet, à la suite de la crise de réplication qui affecte encore la psychologie, on peut émettre de forts doutes sur la qualité des données dont nous disposons.
Je ne tenterai pas de répondre frontalement à cette objection en perdant mon temps à présenter et à évaluer la qualité du corpus sur lequel s'appuient les théories alternatives à la psychanalyse. Cela n'a guère de sens, d'autant qu'il me semble que l'objection peut être contournée en proposant un ensemble de preuves convergentes en faveur de ces données, qui proviendraient non seulement de la psychologie, mais aussi de multiples disciplines. En tout état de cause, il me semble plus juste de répondre en sapant les fondements mêmes de l'édifice freudien.
Pour ce faire, je suivrai une double ligne d'argumentation. L'idée est simple : ce ne sont pas nos données et théories actuelles qu'il faut rejeter, mais celles de Freud, car elles ne reposent ni sur une méthodologie solide ni sur des données empiriques fiable. En premier lieu, compte tenu des falsifications et des mensonges dont Freud s'est rendu coupable, le matériel clinique qu'il utilise dans ses écrits ne peut avoir aucune valeur épistémique. Ensuite, ce matériel, même s'il avait une valeur, ne lui permet pas de défendre les conclusions qu'il veut défendre parce qu’il est bien trop faible. De plus, pour des raisons que Grünbaum analyse en détail, l'argument que Freud utilise pour défendre ses théories n'a aucune force.
Freud pourrait être sauvé si des études empiriques indépendantes confirmaient ses théories. Or, mon impression actuelle que de telles études n'existent pas. Cela signifie-t-il que ni la psychodynamie contemporaine ni la neuro-psychanalyse n'ont de base empirique avérée? Pas du tout! Je ne ferai pas de pari sur le sujet pour le moment, car je suis loin d'avoir une vision claire de toute cette littérature.
Une dernière ligne d'argumentation que je compte explorer pour tenter de justifier un rejet de Freud est de montrer, de manière un peu caricaturale, que ses bonnes idées ne sont pas les siennes. En un sens, certains des concepts fondateurs de la psychanalyse ont en fait été empruntés à des contemporains tels que Pierre Janet, William James, Nietzsche et d'autres. Freud n’est de ce point de vue pas un pionnier important à qui il faut reconnaitre un rôle prépondérant, mais un simple acteur parmi d’autres.
Voilà en gros les idées que j'ai l'intention d'explorer et les arguments que j'ai l'intention de défendre. Comme il s'agit d'un projet à long terme, j'ai encore beaucoup de recherches à faire pour présenter ces arguments de la manière la plus complète et la plus convaincante possible. Cependant, il se peut que je me trompe et que je me rende compte, au fil de mes lectures, que la position psychanalytique est plus forte que je ne le pensais. S'il s'avère que j'ai tort quelque part, je n'aurai aucun problème à modifier mon argumentation, voire à admettre que j'ai tort. Comme le disait Keynes, quand les faits changent, je change d'avis. Et je suis du même avis que Socrate qui, dans le Gorgias, dit :
Je suis quelqu’un qui est content d’être réfuté, quand ce que je dis est faux, quelqu’un qui a aussi plaisir à réfuter quand ce qu’on me dit n’est pas vrai, mais auquel il ne plait pas moins d’être réfuté que de réfuter. En fait, j’estime qu’il y a plus grand avantage à être réfuté, dans la mesure où se débarrasser du pire des maux fait plus de bien qu’en délivrer autrui. Parce qu’à mon sens, aucun mal n’est plus grave pour l’homme que se faire une fausse idée des questions dont nous parlons en ce moment. (Gorgias, 458 a)
La psychanalyse est-elle une science ?
Il y a cependant trois questions au sujet desquelles je n'ai pas l'intention de m’étendre. La question de la scientificité de la psychanalyse, celle de son efficacité, et celle de son incohérence théorique interne. La première ne me paraît pas particulièrement intéressante. La science est un ensemble d'institutions dont la fonction est de produire des idées et d'assurer leur exactitude à l'aide d'un ensemble de processus socio-techniques. Si les psychanalystes jouent le jeu de ces institutions, alors la psychanalyse est une science. S'ils refusent d'inscrire leurs pratiques dans le cadre de ces institutions, alors la psychanalyse n'est pas une science. C'est aussi simple que cela. Répondre à cette question nécessiterait une enquête sociologique, que je n'ai pas les moyens de mener, et dont les résultats ne m'intéressent que modérément, car je ne sais pas ce qu'il y a à en apprendre. Quoi qu’il en soit, quand bien même la psychanalyse ne serait pas une science, cela ne changerait rien au status de ses théories qui, elles, peuvent tout à fait être étudié de manière scientifique. Je reviendrai prochainement sur ce dernier point.
La question de l'efficacité est plus intéressante et de nombreux travaux ont déjà été réalisés à ce sujet. Cela dit, la base même du problème me semble conceptuellement trop floue pour que l'on puisse apporter une réponse qui permettrait de trancher le débat. Comment, sans savoir ce qu'est un trouble mental, peut-on espérer évaluer l'efficacité d'une thérapie qui tente de le traiter ? La psychologie clinique a encore de beaucoup de travail à faire. D'ici là, je resterai à l'écart des débats sur le traitement des troubles mentaux. La question de la cohérence interne des théories freudienne, quant à elle, nécessiterait un long et difficile travail d’exégèse qui ne m’intéresse pas le moins du monde et qui n’apporterait absolument rien à mon projet actuel, je n’ai donc aucune raison de le faire.
Ce billet est une traduction et adaptation d’un billet que j’ai partagé sur mon autre substack: